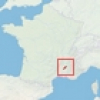Informations générales

- Restauration et préservation des milieux aquatiques, des zones humides et de leurs écosystèmes
- Gestion des risques d'inondation dans le respect des milieux aquatiques et humides
- Préservation de la ressource naturelle et son partage entre les usages
- Restauration et maintien de la qualité des eaux
- Pérennité de la gouvernance partagée entre les maîtres d'ouvrage du SAGE
Caractéristiques
- Cours d’eau : le Lez, la Mosson, leurs principaux affluents.
- Les étangs Palavasiens : lagunes littorales, milieux saumâtres particulièrement sensibles, situés entre Sète et Montpellier, appelés les étangs Palavasiens.
- Le littoral : milieu d’une grande fragilité, soumis à une forte érosion. La CLE fait partie du comité de suivi des résultats du milieu marin réalisés dans la zone d’influence du rejet des effluents par l’émissaire en mer de la station d’épuration MAERA.
- Les ressources souterraines : la principale ressource en eau souterraine est la source du Lez, ressource karstique qui alimente en eau potable une grande partie de Montpellier Métropole.
Le périmètre du SAGE s’étend du Pic Saint-Loup à la mer. Il a une superficie de 652km² (12% de la superficie de l’Hérault) qui correspond au bassin versant superficiel du Lez, de la Mosson et des Etangs Palavasiens. Il est constitué de 43 communes.
Le SAGE de 2003 présente un bilan positif et a permis un développement important des connaissances sur le bassin versant et voit la mise en place de réseaux de suivis liés aux objectifs de bon état des masses d’eau. Il a également permis une amélioration sensible de la qualité des eaux sur les milieux aquatiques, cours d’eau, étangs et littoral par une mobilisation des maîtres d’ouvrage sur l’assainissement et sur une politique intégrée de réduction des risques d’inondation.
Le SAGE révisé intervient sur un territoire dont l’évolution a connu une poussée démographique sans précédent dans les deux dernières décennies et a conduit la Région Languedoc Roussillon à porter un projet de sécurisation de la ressource par des apports supplémentaires d’eau brute du Rhône (Aqua Domitia). L’alimentation en eau potable de l’agglomération de Montpellier dépend cependant essentiellement de la source du Lez, qui a fait l'objet d'une étude sur le fonctionnement du karst afin de suivre l'évolution quantitative de l'aquifère et les potentialités d'exploitation.
Si un soulagement des prélèvements sur la ressource patrimoniale pour l’eau potable est envisagé avec le projet Aqua Domitia en réduisant la consommation de cette dernière pour les usages externes (arrosage, piscine, espaces verts...), un développement de la consommation n’est pas à exclure par l’offre faite à l’agriculture et la possibilité de potabiliser l’eau sur certains secteurs.
La montée démographique doit se poursuivre dans les années à venir avec une population d’environ 500 000 habitants à l’horizon 2020, soit 80 000 personnes de plus qu’en 2011. Cette montée démographique se réalise par ailleurs dans un contexte de risques d’inondation majeure, notamment par submersion marine et sur un territoire dont l’économie touristique introduit des variations importantes de population.
Elle s’est accompagnée jusqu’ici d’une artificialisation rapide des espaces naturels qui s’est infléchi dans les dernières années en raison des orientations du SCOT de Montpellier vers une densification de l’espace. La consommation d’espaces naturels devrait donc ralentir encore mais reste un enjeu majeur pour le SAGE sur un territoire où l’activité agricole est un facteur d’équilibre important menacé par l’évolution des types de cultures.
L’importance stratégique des étangs palavasiens a permis la mise en place de fortes démarches de préservation des espaces remarquables (Natura 2000) sur lequel le SAGE peut aujourd’hui s’appuyer pour accompagner la régulation des usages polluants.
Les principales conséquences attendues de l’évolution tendancielle du territoire pour l’eau sont donc une atteinte physique des milieux aquatiques par une consommation continue des espaces fonctionnels pour l’eau, une augmentation des besoins en eau menaçant les équilibres quantitatifs de la ressource et l’augmentation des flux de pollutions, en particulier diffuses, dans les milieux aquatiques déjà soumis à l’eutrophisation en dépassant les capacités naturelles d’épuration de ces milieux.
Enfin, une nouvelle menace est récemment apparue sur le territoire avec l’autorisation de travaux de recherche sur l’exploitation des gaz de schiste pour laquelle la CLE s’est prononcée fermement contre.
- Préservation des milieux aquatiques et humides et de leur espace de fonctionnement
- Eutrophisation des étangs
- Gestion préventive des inondations en tenant compte du bon fonctionnement des milieux aquatiques et humides
- Gestion des étiages et économies sur la ressource en eau
- Alimentation en eau potable du territoire
- Lutte contre les pollutions
- Gouvernance de l'eau
Les bassins versants du Lez et de la Mosson prennent naissance dans des collines calcaires situées au nord. Les parties aval occupent une plaine alluviale qui se termine en baie ouverte sur la mer. Le fleuve Lez et la rivière Mosson se jettent dans un complexe de lagunes littorales qui communiquent entre elles, et en mer. Le canal du Rhône à Sète, qui traversent ces étangs, est également en communication avec eux. Ces cours d'eau méditerranéens présentent des écarts de débit importants au cours de l'année, avec des variations brutales en période d'orage. Les précipitations annuelles sur le bassin versant sont de 750 mm, mais elles ne sont pas réparties uniformément au cours de l'année.
La partie nord du bassin présente un aquifère karstique dont le fonctionnement est très mal connu (on pense qu'il y a 90% de l'eau du bassin versant qui circule en souterrain). Les étangs littoraux constituent des milieux naturels remarquables qui font l'objet de procédures de protection (sites classés, sites inscrits, ...). On notera que 25 % de la surface du bassin est inscrite en ZNIEFF (45 zones). Le parcours du Lez est ponctué de seuils et de moulins. En amont, son lit reste relativement naturel. Il a été entièrement endigué à partir de la traversée de Montpellier (notamment pour lutter contre les inondations).
Le Lez et la Mosson sont des cours d'eau non domaniaux. A partir du croisement avec le canal du Rhône à Sète, le Lez devient domanial. Les étangs non domaniaux sont propriété soit de personnes privées soit de personnes publiques. Par ailleurs, ils sont classés en zone sensible et font l'objet d'un programme LIFE.
La population inscrite dans le périmètre du SAGE est de 417 266 habitants. L'occupation du sol est approximativement la suivante : 25 % urbain, 35 % rural, 35 % forêts et garrigues, 5 % étangs. Les principales activités économiques sur le bassin sont : la vigne en milieu rural et le tertiaire en milieu urbain. L'activité de pêche (en particulier en étang) reste artisanale et traditionnelle. En terme d'usages de l'eau, on notera l'importance des prélèvements en eau (majoritairement dans le karst) pour l'AEP et les équipements de loisirs (golf, terrains de sport, plans d'eau) et des rejets domestiques dans le Lez (problème de saturation de la station d'épuration de Montpellier).
La navigation de plaisance s'exerce sur le canal du Rhône à Sète et sur les 3 derniers kilomètres du Lez. Le Lez et, dans une moindre mesure, la Mosson sont sensibles aux inondations. Ce phénomène concerne également les étangs (inondations par la mer). La station d'épuration de Montpellier a été agrandie et modernisée. Un émissaire en mer a été mis en place. Il n'y a pas de problème de saturation.
Déroulement et état d'avancement
La CLE a adopté une première fois le SAGE le 13 mars 2003.
Une révision a été lancée en septembre 2009. Le projet de SAGE a été validé par la CLE le 09 janvier 2014. De février à juin 2014, le projet de SAGE a été soumis à la consultation des assemblées. Lors de la séance de la CLE du SAGE Lez-Mosson-Etangs Palavasiens en date du 02 décembre 2014, le projet de SAGE révisé a été adopté. L'arrêté d'approbation a été signé par le préfet de l'Hérault le 15 janvier 2015.
Emergence
Instruction
Elaboration
Mise en œuvre
1ère Révision
Commission Locale de l'Eau
- Bureau: 13 membres, organe restreint qui prépare les réunions de la CLE
- Comité technique: techniciens associés à la démarche SAGE
- 5 Commissions thématiques
Structure porteuse et animation
Domaine de Restinclières
34730 PRADES LE LEZ
France
Fonctionnement
123 soleil
BRL i
- Agence de l'Eau : 50 %
- EPTB Lez : 50%
Demande de subvention en fonction des études à l'Agence de l'eau, à la DDTM 34, à la Région Languedoc-Roussillon, au Conseil Général de l'Hérault. Part d'autofinancement : EPTB Lez
Informations de référence
Documents
Documents généraux
Vie des territoires
Guide méthodologique
Témoignage
Documents des SAGE
Arrêtés et délibérations
Arrêtés de périmètre
Arrêtés de composition de CLE
Arrêtés d'approbation
Documents constitutifs du SAGE
Etat des lieux
Stratégie
Plan d'aménagement et de gestion durable (PAGD)
Règlement
Atlas cartographique
Règles de fonctionnement de la CLE (bureau, commission, ...)
Evaluation environnementale
Etudes et rapports
Actions de communication
Lettres d'information
Plaquettes
Guides
Documents des PTGE
Documents constitutifs du PTGE
Programme d'actions
Etudes
Gestion quantitative (VP, HMUC, ...)
Croisement de données
Exporter des données :
| EXPORTER LA LISTE DES COMMUNES |
| EXPORTER LA LISTE DES MASSES D'EAU |